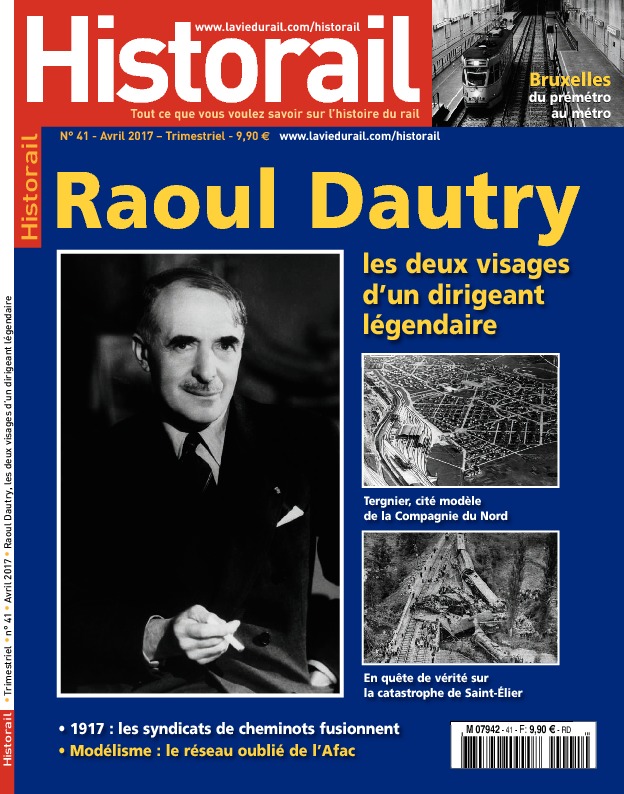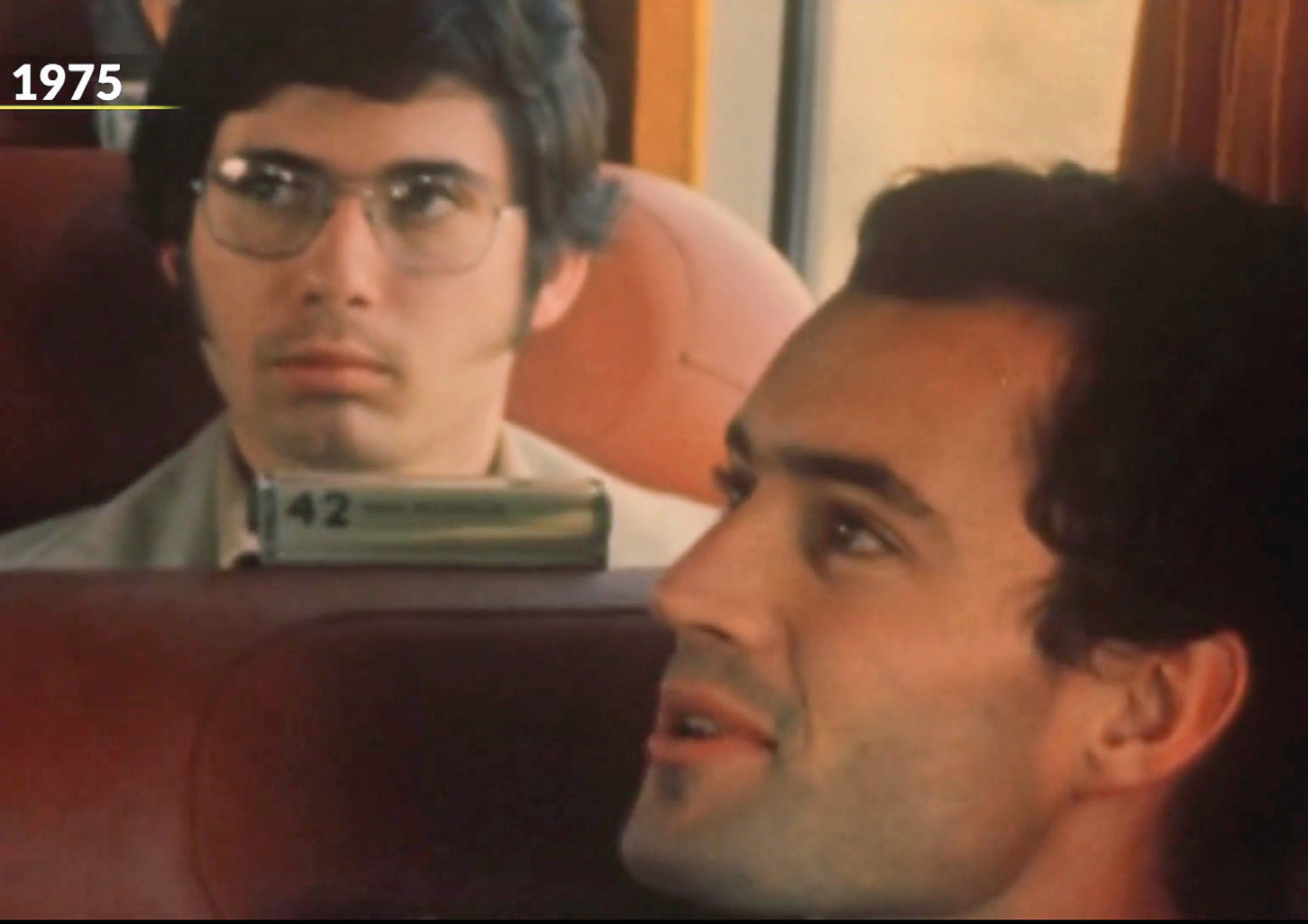Ouvert en 1976, le réseau de métro bruxellois est aujourd’hui doté de six lignes dont deux exploitées en tramways. Construit à partir de 1969, il est passé par le prémétro permettant la transition entre les tramways et les rames de métro. Un temps en concurrence, les deux modes sont désormais complémentaires dans un ensemble intégré. Pour ses 40 ans, le métro se lance dans la construction d’une nouvelle ligne.
Pour les Français habitués aux réseaux de tramways de l’Hexagone, Bruxelles et ses 16 lignes peut paraître assez impressionnant. Pourtant, la capitale belge n’est pas un cas isolé en Europe et les villes voisines en Belgique même, en Suisse ou en Allemagne présentent des réseaux plus développés encore. À Bruxelles, le tram est resté au coeur des déplacements de la ville.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il occupe encore largement le haut du pavé bruxellois, peu concurrencé par l’autobus. Depuis 1939, la ligne 54 a été transformée en trolleybus, mais il s’agit là d’un cas isolé et ce mode de transport ne sera pas repris sur d’autres lignes. Le tramway quadrille littéralement la ville, n’hésitant pas à s’engager dans des rues parfois étroites et sinueuses. Cette desserte fine ne l’empêche pas d’être également bien présent le long des plus importantes artères, à l’image de l’axe nord-sud constitué par les boulevards qui relient les gares du Nord et du Midi. Les deux gares sont d’ailleurs enfin reliées entre elles en 1952 grâce à la jonction centrale qui permet la continuité entre les deux réseaux. Cette liaison de 3,8 km en pleine ville pourrait d’ailleurs par certains côtés revêtir un caractère urbain puisqu’elle dessert en réalité trois nouvelles gares, la gare Centrale et les stations de Chapelle et Congrès. Faut-il y voir l’amorce d’un réseau de métro que la ville appelle de ses voeux depuis si longtemps? À y regarder de plus près, il s’agirait plutôt d’une desserte grandes lignes qui n’est pas à proprement parler destinée à un service urbain.
Outre l’axe nord-sud, les tramways sont également bien présents le long de la Grande Ceinture, un ensemble de boulevards qui contourne par l’est la ville historique. Sur l’emplacement des anciennes fortifications, les boulevards de Petite Ceinture assurent pareillement un tour du coeur de Bruxelles. Plusieurs lignes s’inscrivent ainsi sur des relations nord-sud ou circulaires le long de ces axes majeurs.
Engager la modernisation
Au sortir de la guerre, il devient important de moderniser un parc de tramways devenus vétustes. Une certaine réorganisation des transports s’impose également. C’est en 1954 qu’est ainsi créée la Stib, Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Fortement éprouvés par le second conflit mondial, les transports publics peinent à faire face dans un contexte de concurrence. Néanmoins, le tramway qui a d’indéniables qualités a une carte à jouer. Encore faut-il procéder à sa modernisation. À la différence d’autres réseaux comme en France, les anciens matériels roulants surexploités durant le conflit sont progressivement remplacés par des motrices modernes. Le Comité provisoire mis en place dans l’immédiat après-guerre pour la gestion du réseau se lance assez tôt dans la modernisation du tram. L’alimentation électrique est ainsi renforcée avec la construction de quatre sous-stations supplémentaires. Côté matériel roulant, les voitures les plus anciennes sont reconstruites et transformées. 787 motrices et 416 remorques profitent de ce rajeunissement, équipées notamment de portes à fermeture électropneumatique. Mais ces modernisations restent une solution provisoire permettant seulement d’allonger de quelques années la durée de vie du matériel. En parallèle, on passe commande de nouvelles rames de type PCC (Presidents Conference Committee), à l’image des matériels les plus modernes mis au point dans les années 1930 aux États- Unis. Les 50 premières motrices arrivent à partir de la fin 1951 sur le réseau bruxellois. Ces rames modifient