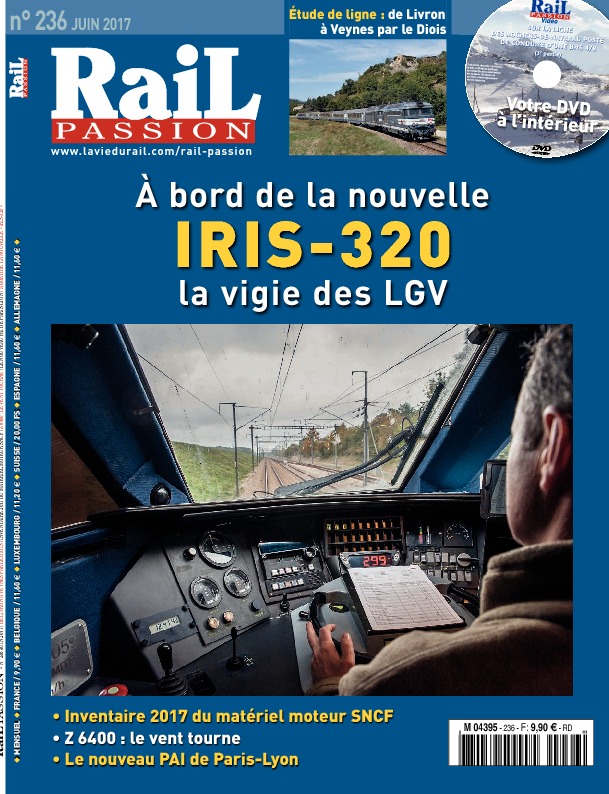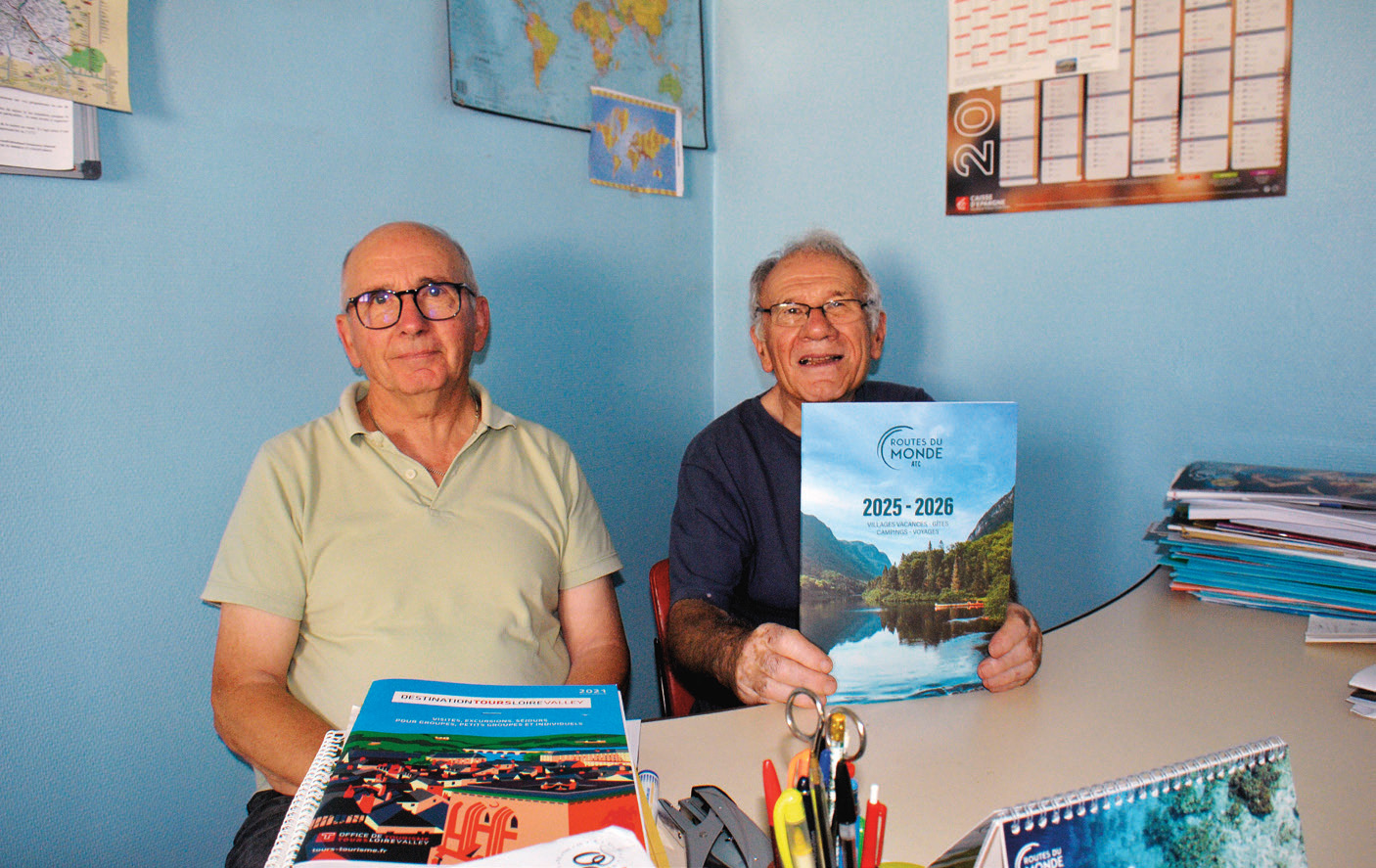L’interruption totale du trafic à Paris-Lyon les 18 et 19 mars a permis la mise en service d’un PAI moderne en remplacement des postes I et II de la gare, datant des années 30. Cette opération, qui a nécessité cinq ans de préparation, est la première étape de l’installation de la commande centralisée du réseau de Paris-Sud-Est, située à Vigneux.
En 48 heures, les 18 et 19 mars 2017, la commande des postes d’aiguillage de l’une des plus importantes gares du réseau ferroviaire français a fait un bond technologique d’un siècle. Et pourtant, ils avaient fière allure, ces postes I et II de Paris-Lyon, abrités dans ce bâtiment dominant la gare au milieu des voies, juste au bout des quais.
C’est à l’issue d’un grand remodelage de la gare, en 1927, avec la construction de la nouvelle plateforme de départ de neuf voies supplémentaires 3 à 19 et le transfert de l’atelier du matériel du Charolais à Villeneuve, que sont construits ces postes, mis en service respectivement en juin 1933 pour le poste I (plate-forme des voies à lettres) et janvier 1934 pour le poste II (plate-forme des voies à chiffres).
Ils appartiennent à la famille des postes à combinateur mécanique et à barres d’itinéraires type Thomson-Houston. 29 postes de ce type ont été installés et le premier fut celui de Lyon-Perrache 2 en 1925, remplacé par un PRS (poste tout relais à transit souple) en 1952. L’ultime exemplaire encore en service après ce weekend est celui de Mâcon, de 1952 (120 itinéraires).
Le poste I disposait de 320 leviers et le poste II de 160. Chaque poignée servait à commander un itinéraire par l’intermédiaire de deux mouvements successifs : traction pour lancer la commande des aiguilles puis rotation pour permettre l’ouverture des signaux. On disposait ainsi de 400 itinéraires au poste I et 270 au poste II. Au cours de leur longue existence, ces postes n’auront eu qu’une seule grosse opération d’adaptation : entre 1947 et 1950, pour les travaux de reprise du plan de voies des gares de Lyon et Bercy dans le cadre de l’électrification. À ce moment-là, l’ensemble de ces postes constitue le plus grand poste à leviers d’itinéraire d’Europe. Ils résisteront à la création de la gare souterraine banlieue et même à l’arrivée du TGV en 1981. Il faut dire qu’à cette époque peu de gens croient en l’avenir du chemin de fer. Les travaux de cette première LGV tout comme les installations terminales se font dans le strict respect des deniers de l’entreprise et à moindre coût. Et le renouvellement des postes d’aiguillage, qui ont déjà 50 ans, ne fait pas partie du projet. Il n’en sera pas de même pour les autres gares parisiennes, qui auront toutes des postes modernes lors de l’arrivée des rames à grande vitesse.
Et, les années suivantes, l’intensité du trafic refroidit toutes les ardeurs. La gare pourra quand même se doter de deux voies supplémentaires (21 et 23) pour l’arrivée du TGV Méditerranée.
Cependant, tout en accomplissant chaque jour le travail pour lequel ils ont été construits, en acheminant correctement près de 1 000 trains quotidiens, les postes vieillissent inéluctablement. Et l’inquiétude grandit quant à la capacité à entretenir le coeur même de leur dispositif (la table d’enclenchement, les verrous, les tringles, les relais de 1950, le câblage en fils de coton), que ce soit du côté des compétences du personnel ou du côté des pièces. Chez les industriels spécialisés, il y a longtemps qu’on a changé d’époque. L’obsolescence guette les postes I et II. Ces postes sont aussi un handicap au développement du trafic de la