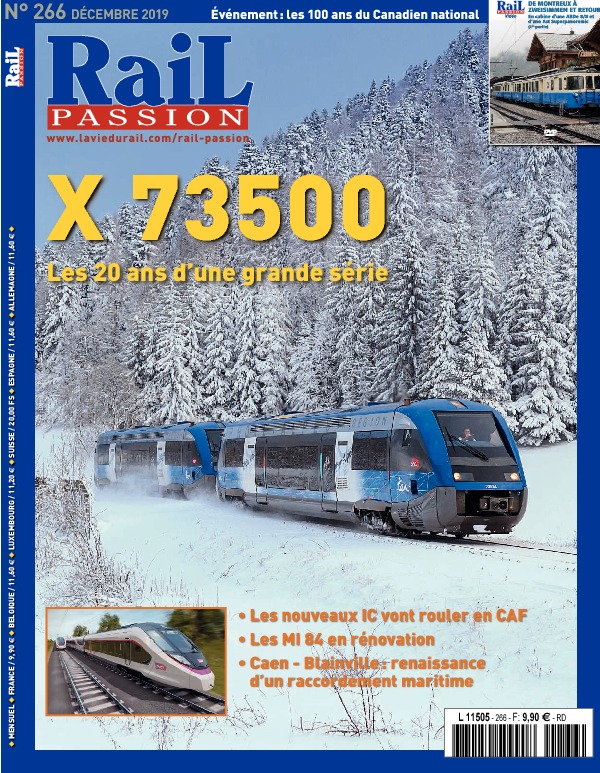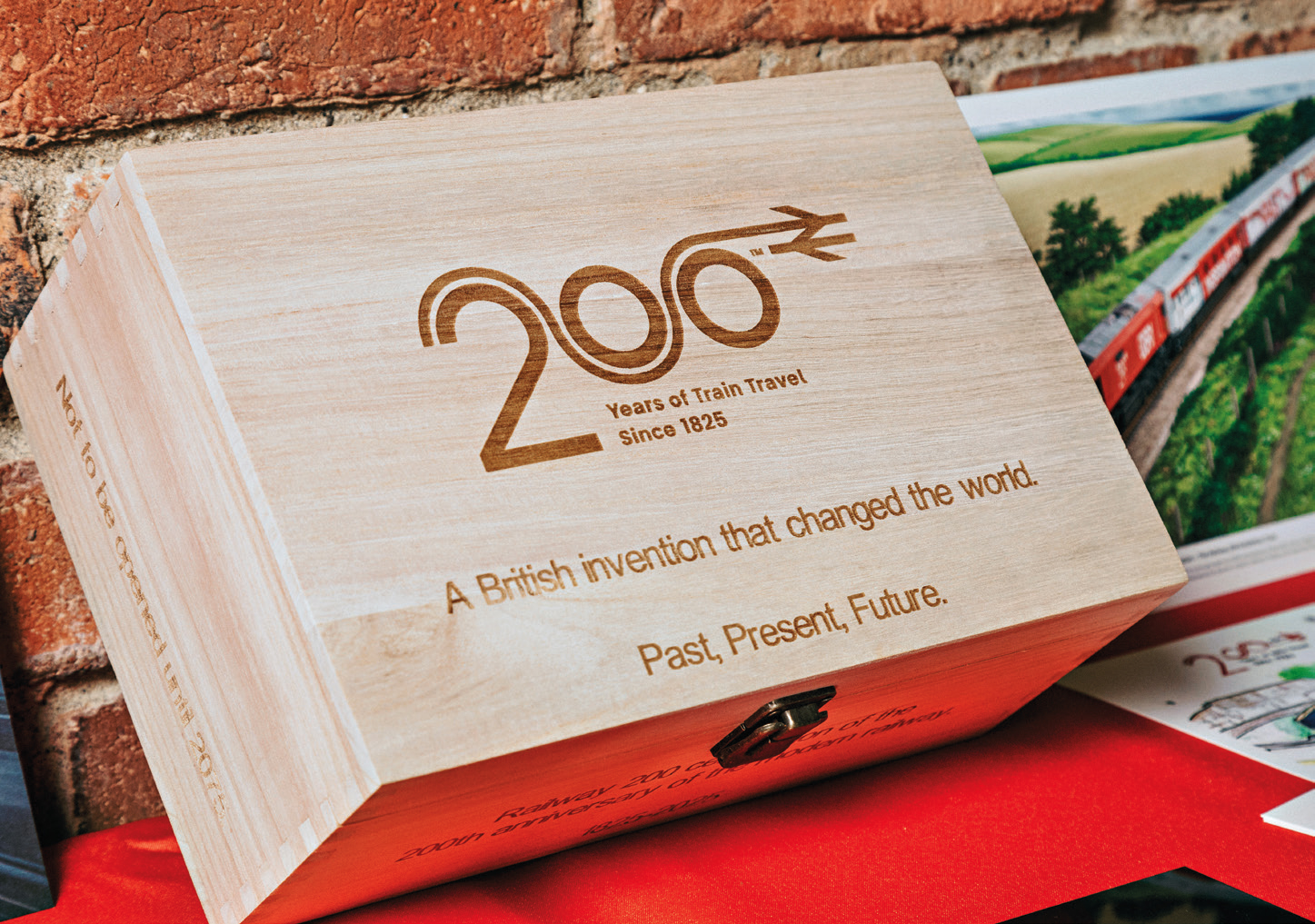Bientôt, le visage de la ligne 6 sera modifié avec l’arrivée d’un nouveau matériel roulant, le MP 89, venu de la 4. Prévu pour 2021, le compte à rebours est lancé, alors que la restauration de la partie aérienne de l’infrastructure de la ligne se poursuit.
En cette fin de XIXe siècle, la guerre fait rage à Paris. D’un côté, les partisans d’un métro souterrain qui se jouera plus facilement des encombrements de la ville. De l’autre, les défenseurs d’un chemin de fer aérien qui seul permettra d’évacuer les fumées des locomotives à vapeur. Les adeptes du viaduc sont prêts à éventrer quelques immeubles et à défigurer les plus beaux monuments de Paris pour la bonne cause.
À l’aube du xxe siècle, à l’heure de la réalisation de ce métro, les ingénieurs de la Ville de Paris avec à leur tête Fulgence Bienvenüe feront heureusement les bons choix, optant pour la traction électrique et un métro circulant en tunnel. Fin de la partie ? Pas tout à fait. Le passage en viaduc a aussi ses avantages, notamment pour franchir des obstacles. Et ce n’est pas ce qui manque à Paris. Dès la première ligne en 1900, le franchissement du canal Saint-Martin place de la Bastille s’opère en viaduc. Sur la ligne 2, il y a une série délicate, le faisceau de voies de la gare du Nord, celui un peu plus loin de la gare de l’Est et pour finir le canal Saint-Martin. Dans ce quartier périphérique de peu d’attrait architectural, on choisit donc de passer en viaduc entre les stations Anvers et Combat (devenue Colonel-Fabien). Pour autant, les ingénieurs font le choix de construire une structure légère et élégante qui sera comme posée délicatement sur le sol. Les quatre stations aériennes, aujourd’hui dénommées Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Stalingrad et Jaurès, sont réalisées avec soin, ornées de nombreux motifs décoratifs. Cette première ligne avec une longue section aérienne constitue la partie nord d’une circulaire qui doit se compléter au sud par deux autres lignes, 5 et 6. Sans trop entrer dans le détail historique de la nomenclature des lignes du métro, la boucle sud est aujourd’hui constituée d’une seule ligne 6 d’Étoile à Nation. Là encore, les obstacles sont nombreux avec pour commencer le franchissement des faisceaux ferrés des gares de Bastille, d’Austerlitz et des Invalides. Mais bien pire, il y a deux traversées de la Seine. Pour s’en affranchir, on prévoit là encore passer en viaduc. Sur l’ensemble de l’actuelle ligne 6, il y a quatre sections aériennes, plus ou moins longues. Les deux franchissements de la Seine en constituent les obstacles majeurs, avec à l’ouest une difficulté supplémentaire avec la proximité de la tour Eiffel. L’ingénieur Jean-Camille Formigé est chargé plus spécialement de concevoir ces ouvrages d’art qui doivent être aussi légers qu’élégants.
Ces structures sont aujourd’hui plus que centenaires et malgré la qualité de leur réalisation, il était indispensable de les reprendre en profondeur. L’ensemble du réseau de métro compte trois lignes avec des sections aériennes, outre les 2 et 6 précitées, il y a également un franchissement de la Seine à Austerlitz pour la ligne 5, qui après avoir traversé la gare, se prolonge en viaduc jusqu’à Saint-Marcel. La RATP a lancé une campagne de réfection qui s’est étalée sur plus de 20 ans. Les travaux se divisent en deux phases distinctes : remise en étanchéité et peinture. Les tout premiers chantiers ont commencé en 1997 sur la ligne 6 entre Denfert et Place-d’Italie. Ils ont été suivis en 1999 et 2000 de la mise en étanchéité du viaduc de la ligne 2.