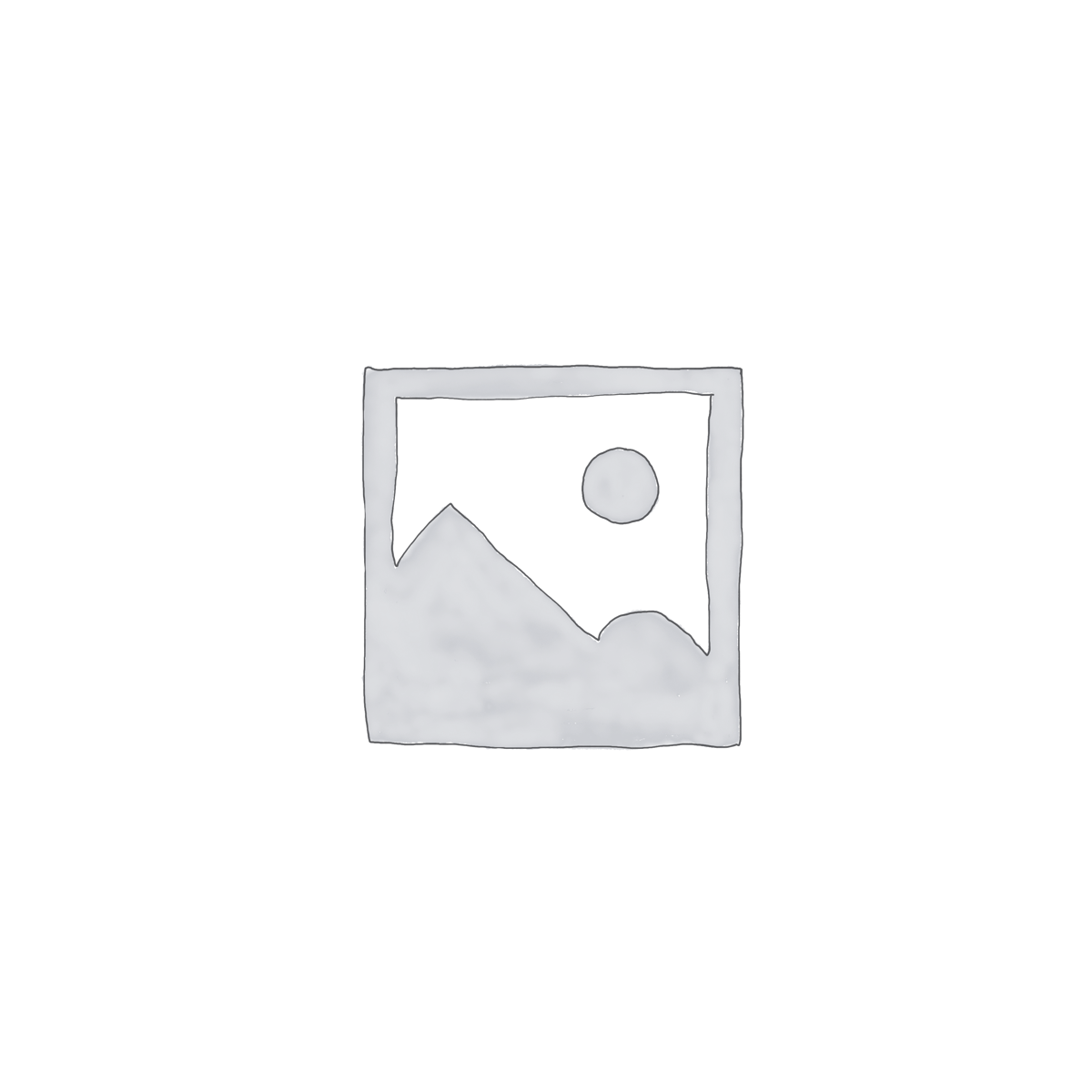Les premières bases d’études pour un tracé d’une ligne ferroviaire vers l’est de la France remontent à 1832. Mais il fallut une dizaine d’années pour aboutir à un projet sérieux. Le chemin de fer de Paris à la frontière d’Allemagne est ainsi une des sept grandes lignes du réseau français qui a été classée par la loi de 1842 sous la monarchie de Juillet. Et il a été nécessaire d’attendre 10 années supplémentaires pour sa mise en service de bout en bout ! Comme toutes les artères comprises dans cette loi, le chemin de fer de Paris à Strasbourg a été d’une importance capitale pour la France et il l’est encore aujourd’hui, même s’il a été en partie détrôné par la ligne à grande vitesse Paris – Baudrecourt (Strasbourg), une voie maîtresse d’aménagement du territoire, d’échanges commerciaux et un cordon ombilical européen essentiel.




Une dizaine d’années plus tard, ayant rejoint la SNCF, alors que, jeune cadre du service de l’exploitation, j’effectuais mes tournées de sécurité dans les postes d’aiguillage et les gares de la partie ex-AL (Alsace-Lorraine) de la ligne, j’avais remarqué dans une de ces dernières, fermée au service de sécurité, une boîte de pétards contenant un modèle très particulier de cet agrès servant à assurer la protection des trains ou des obstacles… Ils n’étaient pas réglementaires avec leur habituelle forme demi-sphérique, percuteur intérieur, et les deux griffes de fixation sur le rail. Un ancien agent m’expliqua qu’il s’agissait des modèles spéciaux utilisés au début des années 50, lorsque le « Gummizug » circulait entre Paris et Strasbourg. J’ai appris, à ce moment-là, que ce modèle spécial évitait de crever les pneus des voitures de la rame Michelin, mais aussi que lesdits trains étaient qualifiés littéralement de « trains caoutchoucs » en patois par les cheminots de la section alsacienne de la ligne ! La boîte en question avait été oubliée longtemps après le retrait des rames sur pneus… Bien d’autres souvenirs me reviennent en mémoire. Alors que j’étais une nouvelle fois revenu sur la ligne, cette fois en tant que chef du prestigieux établissement Exploitation de Nancy, j’ai fait circuler la locomotive à chaudière tubulaire de Marc Seguin sur les rails de la gare de Nancy à l’occasion de l’inauguration de son agrandissement en 1988. Certes, il s’agissait d’une réplique de 1829 construite par M. Gaston Monnier, d’un lycée technique de Paris, mais le succès fut tel qu’il fallut prolonger les navettes durant les deux journées de présentation, alors même qu’un TGV Sud-Est, inédit, stationnait en gare avec beaucoup d’autres matériels modernes… J’ai même été responsable d’une gare fantôme sur la ligne ! Il s’agissait de la gare désaffectée de Nouvel-Avricourt, anciennement gare-frontière de Deutsch-Avri court avant 1918, entre Lunéville et Sarrebourg. Gare monumentale de style néoroman primitif, ses dimensions sortaient vraiment de l’ordinaire avec ses 100 m de long à l’origine ! Une aile ayant été détruite durant la Première Guerre mondiale, le bâtiment voyageurs a perdu une partie de sa superbe, mais il reste, aujourd’hui encore, un élément de décor surprenant dans le paysage !
 Mais l’histoire de la ligne est aussi faite de paradoxes… J’ai, en effet, contribué au fait qu’une page de l’histoire de la ligne 1 se tourne, au moment des âpres discussions relatives au financement du TGV Est. Directeur régional de la SNCF en Lorraine au tournant du siècle, les intenses tractations entre la SNCF, RFF et les collectivités avaient abouti en janvier 1999, grâce aux efforts communs. C’était les prémices d’une disparition annoncée, en 2007, des rapides et express qui assuraient la liaison entre Paris et Strasbourg depuis 155 ans !
Mais l’histoire de la ligne est aussi faite de paradoxes… J’ai, en effet, contribué au fait qu’une page de l’histoire de la ligne 1 se tourne, au moment des âpres discussions relatives au financement du TGV Est. Directeur régional de la SNCF en Lorraine au tournant du siècle, les intenses tractations entre la SNCF, RFF et les collectivités avaient abouti en janvier 1999, grâce aux efforts communs. C’était les prémices d’une disparition annoncée, en 2007, des rapides et express qui assuraient la liaison entre Paris et Strasbourg depuis 155 ans ! La ligne 1 a contribué à la richesse économique et sociale de la France et de l’Europe. Elle a aussi été malheureusement le témoin des horreurs de trois guerres franco-allemandes. Puisse ce magnifique ouvrage, avec son exceptionnelle documentation, enthousiasmer le lecteur. l
Christian Antoine Directeur honoraire de la SNCF