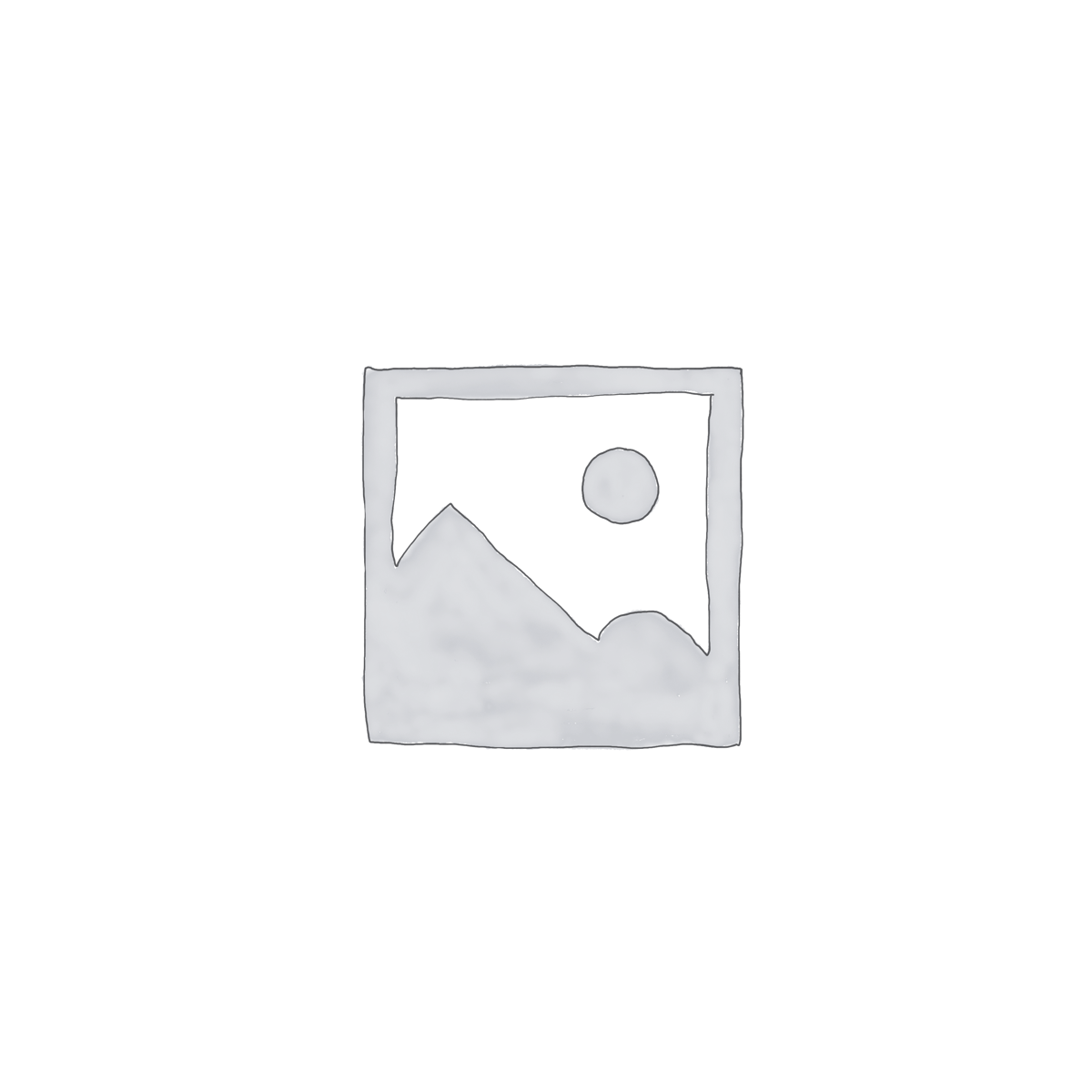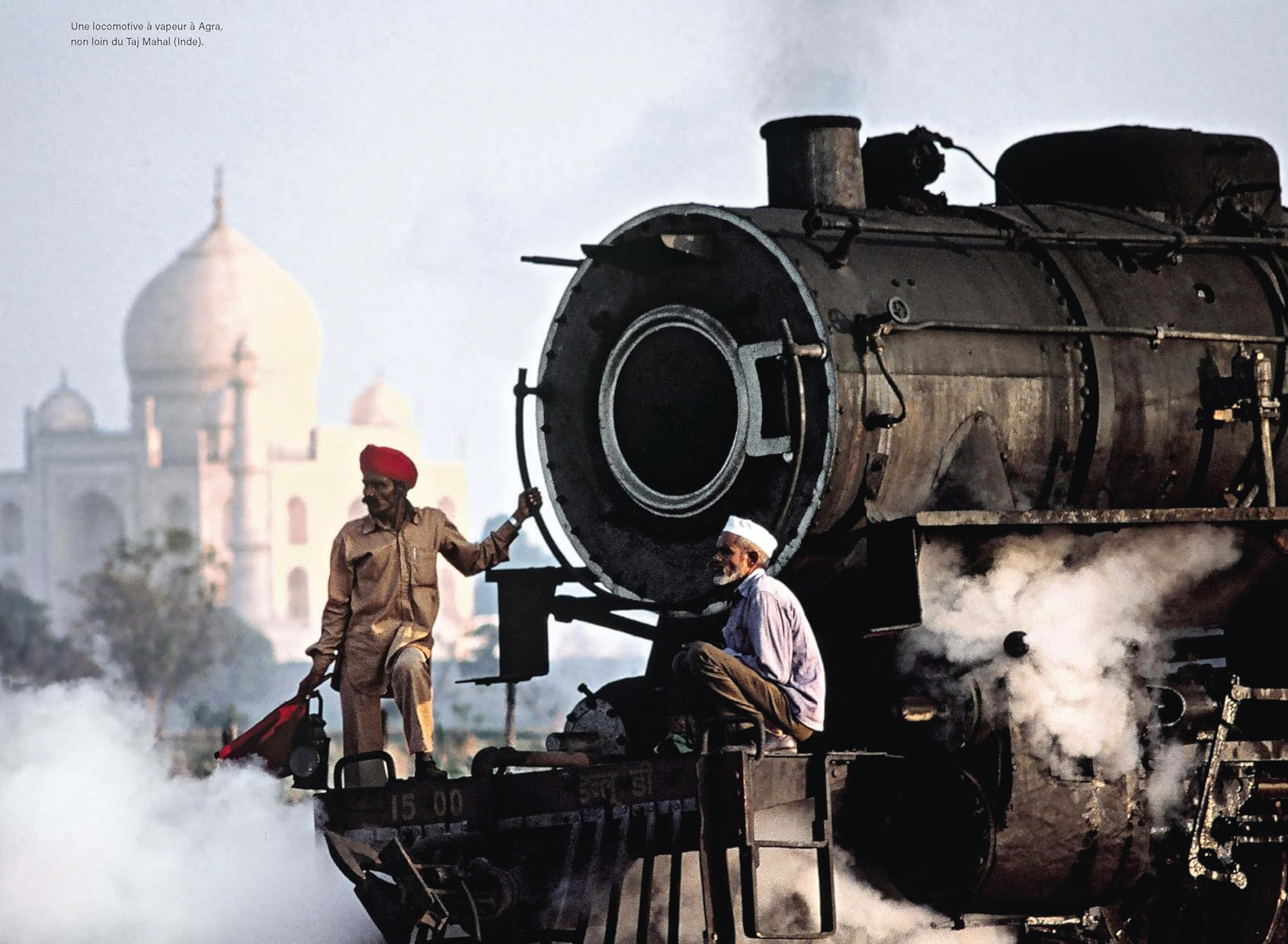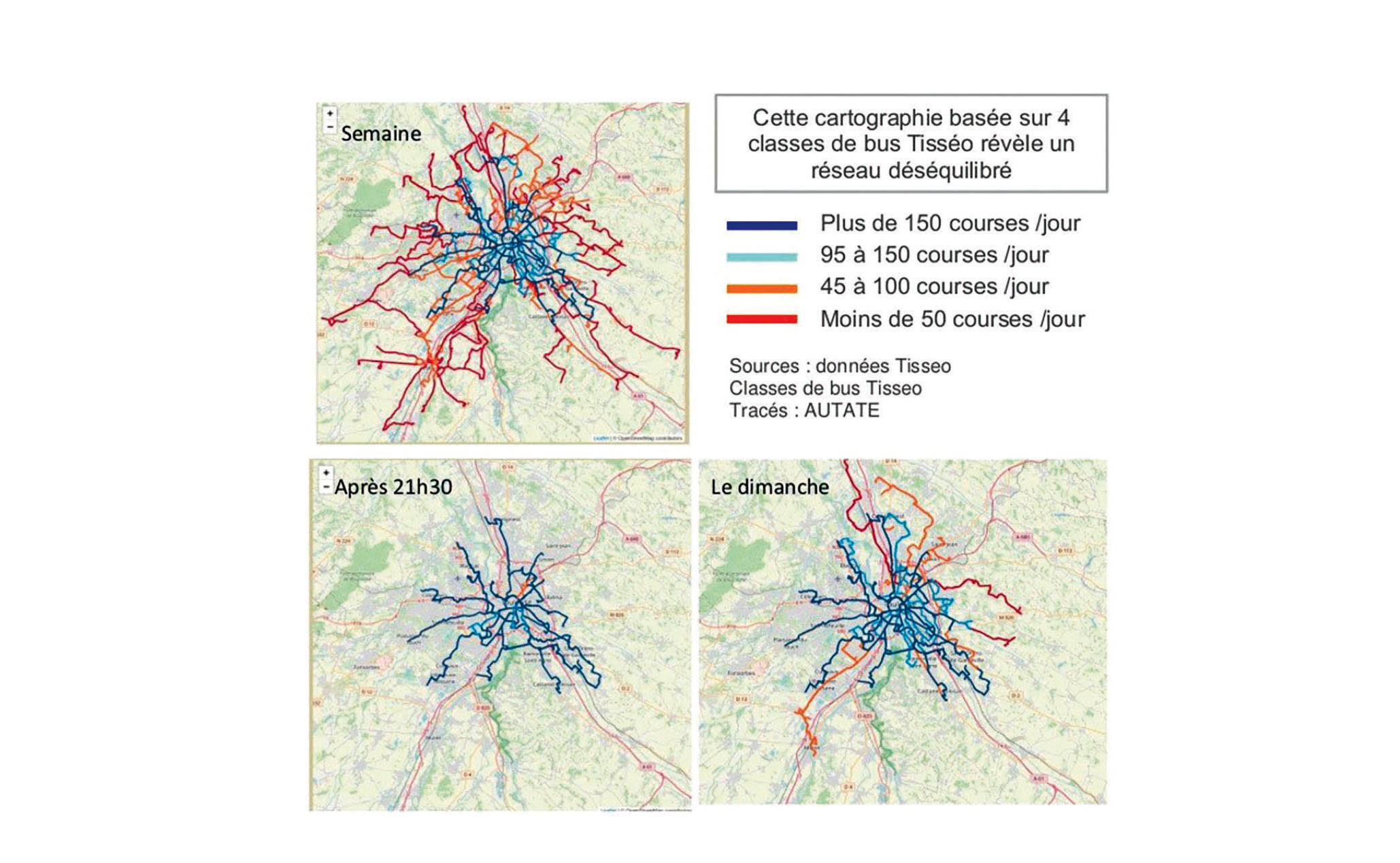Au printemps 1910, le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer fait campagne pour le relèvement des salaires des cheminots : minimum de 5 francs pour tous par journée effective de travail, revendication traduite en un mot d’ordre simple : « La thune pour tous ! » De plus, la loi votée en 1909 instituant un régime des retraites des cheminots n’est pas rétroactive (1) : autre motif de mécontentement. Le refus des grandes compagnies de céder à la pression syndicale contribue à élargir le front social. Sur le Nord, le nouveau régime d’« exploitation intensive » du réseau pousse à bout les roulants, entraînés par le mécanicien Toffin de la Fédération des mécaniciens et chauffeurs (2), ralliée ainsi au Syndicat national.
C’est au Nord que la grève, décidée le 10 octobre, démarre le lendemain, suivie le 12 sur le Réseau de l’Ouest-État, où les leaders du Syndicat national revendiquent une orientation « révolutionnaire », hostiles à tout recours avec le Parti socialiste, en ne comptant que sur l’action syndicale. Ils ont réussi au congrès fédéral de décembre 1909 à mettre un terme à « la dictature » de Guérard, secrétaire général jugé trop « réformiste », sans pour autant s’emparer de la direction fédérale. La grève sera en réalité affaiblie par les vives tensions qui minent les états-majors du Syndicat national.
Qui plus est, le gouvernement s’est préparé à affronter cette grande grève : un plan de mobilisation militaire a été fourbi dans le plus grand secret. Dès le 11, le chef du gouvernement, Briand, décide la mobilisation des cheminots « pour une période d’instruction de 21 jours ». Alors que les refus entraînent de premières révocations, l’armée occupe les gares de la région parisienne et autres centres névralgiques. La géographie de la grève révèle l’ampleur de la fracture interne au Syndicat national : les 43 000 grévistes (13 % des effectifs des réseaux) sont les plus nombreux sur les deux réseaux de l’Ouest-État (15 000) et du Nord (16 000). Les dissensions internes et la répression gouvernementale conduiront à l’échec de la grève : après 10 jours, la reprise est générale le 19 octobre.
En région parisienne, les lignes de banlieue avaient été fortement touchées : aubaine pour les journalistes et photographes de la presse parisienne, découvrant pour la première fois les scènes inédites et pittoresques que suscite la paralysie du trafic sur les lignes de la banlieue ouest. D’un côté, l’envahissement des gares par la gent militaire, malhabile à remplacer les grévistes ; d’autre part, les foules de voyageurs en détresse circulant sur les voies, parfois les cheminots grévistes au pied de leur trophée, une locomotive déraillée… Très nombreuses seront les cartes postales qui figeront ces diverses scènes. Près d’une vingtaine de cartes, marquées « F. F. Paris », caractérisées par une pièce de 5 francs en surimpression rappelant le motif de la grève, seront ainsi abondamment diffusées. Nous reproduisons ici huit photos originales d’une collection appartenant à Pierre Tullin. Chaque photo porte au dos une indication de légende, soit ronéotée en bleu (photos 2, 3, 4, 5, 7), soit manuscrite au crayon (1, 6, 8). Elles ont la même origine, que signale la mention suivante : « Reproduction interdite. Copyright M. Branger Photo-Presse, 5, Rue Cambon, Paris ».
Cet intérêt opportuniste de la presse et des éditeurs de cartes postales pour cette riche manne médiatique n’a pas exclu un traitement plus critique de la grève telle que suivie par des journalistes dépendant d’une presse bien-pensante, respectueuse de l’autorité des grandes compagnies. C’est tout l’intérêt du témoignage du syndicaliste Eugène Poitevin que d’évoquer à la fois le pittoresque de ces scènes de grève et leur signification sociale, mais aussi de pointer les limites « politiques » des reportages qu’elles ont suscités.
Georges RIBEILL