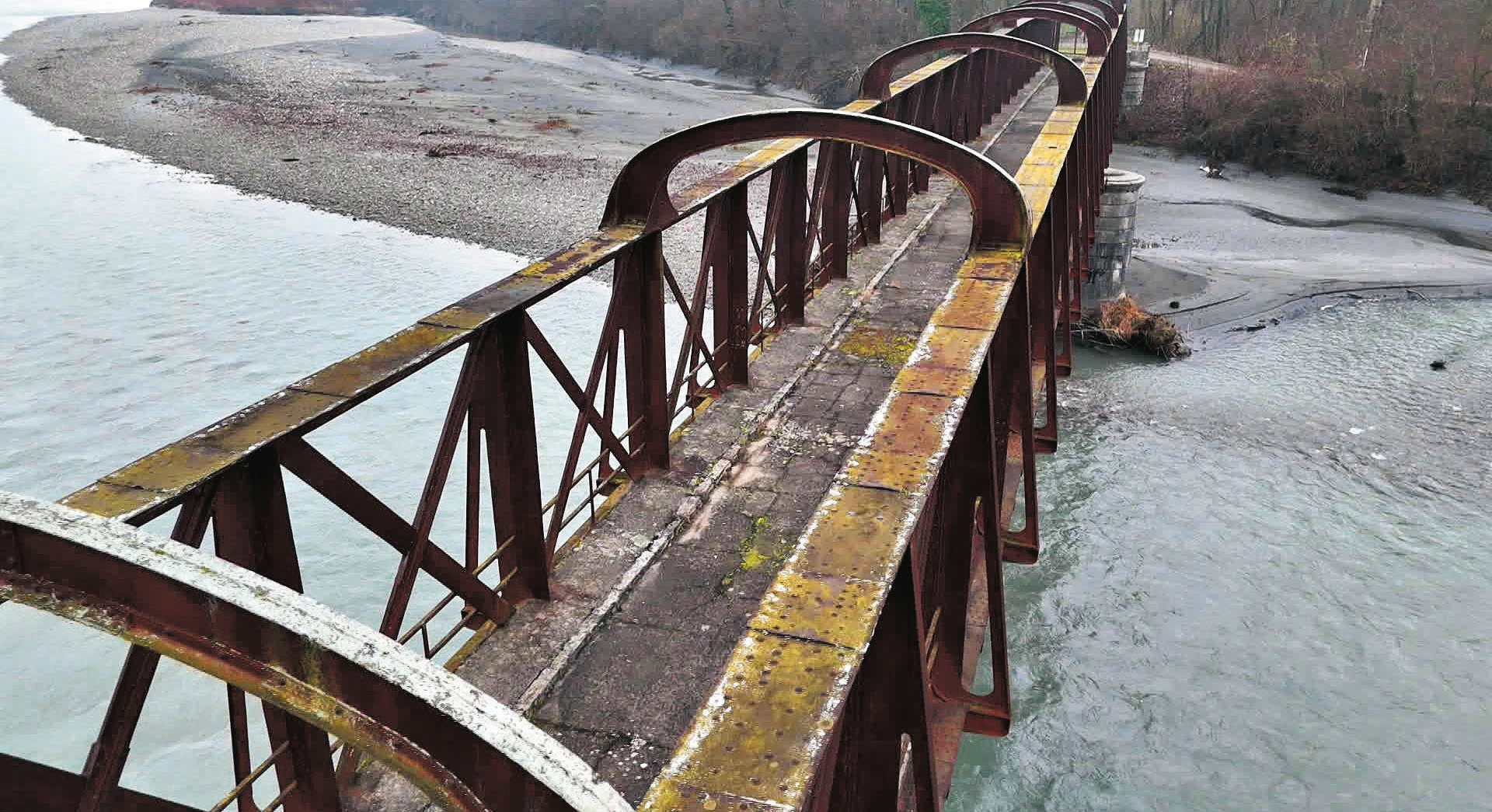La transversale Amiens – Rouen est mise en service à double voie en 1867 pour les trafics voyageurs et marchandises. La ligne va supporter un trafic militaire intense durant les deux guerres. Après-guerre, le trafic fret qui bénéficie des débouchés des ports de Rouen et du Havre est important sur cet axe desservant des régions à vocation industrielle. Aujourd’hui, le trafic marchandises y est sensiblement réduit et l’offre voyageurs demeure modeste.
Conçue d’un commun accord entre les Compagnies de l’Ouest et du Nord, cette transversale numérotée 321 au catalogue RFN unit les vallées de la Somme et de la Seine. D’un développement de 113,6 km, elle traverse les départements de la Somme, la corne septentrionale de celui de l’Oise, puis de la Seine-Inférieure (rebaptisée Seine-Maritime en 1955). Elle démarre en gare d’Amiens à l’altitude 29, d’abord en tronc commun sur deux kilomètres à l’intérieur des quartiers ouest de la préfecture picarde avec la radiale littorale Amiens – Calais, puis se dirige vers le sud-ouest avec une bifurcation à Saleux au Km 7,6 où se détache une voie unique rejoignant Beauvais. En rampe continue pour s’élever sur les ondulations du plateau agricole semi-boisé du pays de Bray, elle dessert Poix-de-Picardie, puis recoupe à Abancourt et à Serqueux les radiales régionales Paris – Dieppe et Le Tréport. Entre deux, elle atteint son point culminant à la cote 228 en gare de Formerie, un second point haut à 210 m se situe au Km 85,690. Laissant à Montérolier- Buchy une voie unique rejoignant Clères, puis la ligne Paris – Le Havre à Motteville, elle descend vers l’agglomération rouennaise et sectionne cette dernière radiale à Darnétal pour aboutir en gare terminus de Rouen-Martainville à 28 m au-dessus du niveau de la mer.
Sa mise en service à double voie est intervenue le 18 avril 1867 pour les voyageurs et le 26 pour les marchandises. Peu après son ouverture, elle connaît l’invasion des Prussiens en 1870, mais s’en sort sans dommages.
Assez curviligne, elle présente néanmoins deux zones en alignement, l’une de 6 250 m en aval de Fouilloy, l’autre de 6 830 m entre Montérolier et Longuerue-Vieux-Manoir. Elle renferme 23 gares et haltes intermédiaires et plusieurs ouvrages en briques à savoir les tunnels amiénois de la Porte-de-Paris et de Longueville longs de 280 m et 198 m, de Famechon (460 m) et de Sommery (1 489 m), les viaducs en maçonnerie de Poix ou de la Faille (246 m) et de Darnétal (263 m). En dehors de courbes tombant à 500 m de rayon à Serqueux, les déclivités n’excédant pas 6 mm/m sauf de Morgny à Darnétal où elles atteignent 11 mm/m.
La gare de Martainville, en cul-de-sac dans les quartiers sud de la ville, justifie la construction d’un vaste bâtiment voyageurs rappelant celui édifié à Soissons, avec corps central encadré de deux pavillons à étages, d’un dépôt de locomotives avec rotonde et d’installations marchandises (débords, halles). À partir de 1878 un raccordement va permettre de relier Darnétal à Sotteville à l’intention des trains de marchandises. En 1885 elle devient l’antichambre des voies de quai du port de Rouen rive droite. Mais l’inconvénient des transbordements obligés de voyageurs en correspondance entre les gares de Martainville et Rouen-Rive-Droite conduit le réseau de l’Ouest à créer des liaisons entre cette gare et Montérolier via Clères et le raccordement d’Étaimpuis. Il faudra attendre le 20 mars 1915 pour que le nouveau réseau de l’État, ayant succédé à l’Ouest en 1909, mette en service le raccordement Darnétal – Rouen-Rive-Droite.
Notons qu’une voie ferrée d’intérêt local à voie normale de 10 km joignant Montérolier à la commune de Saint-Saëns, connue par ses filatures et le travail du cuir, est exploitée par la Compagnie du Nord à compter de 1900.